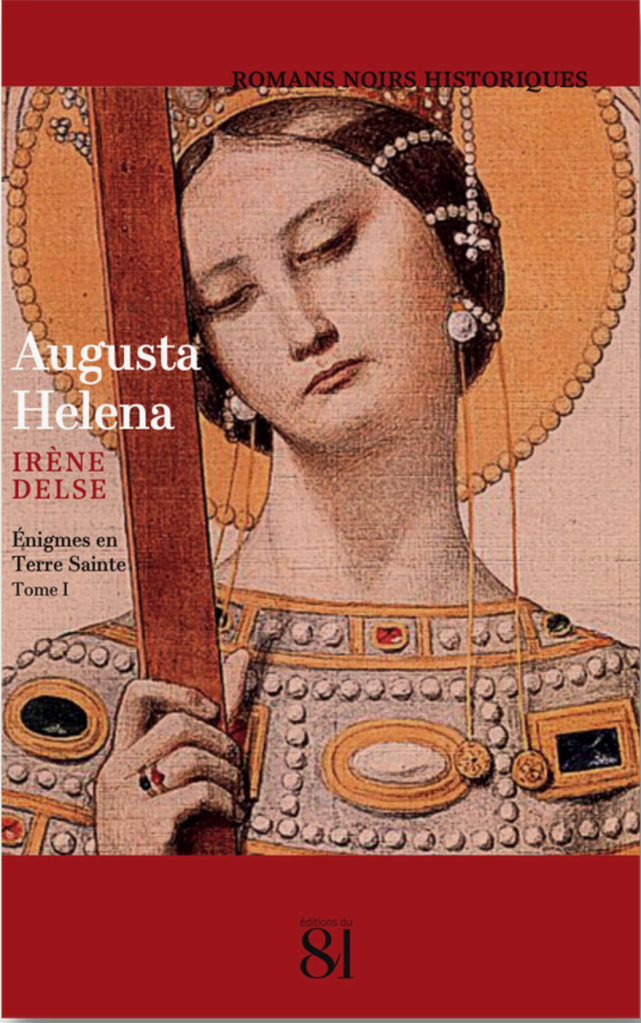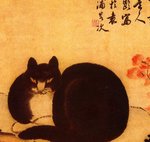On connaît Tolkien pour un créateur de mythologies et de mondes imaginaires, un grand conteur des temps modernes. Mais son œuvre contient aussi une leçon de lucidité et de courage dans l’adversité dont nous aurions bien besoin aujourd’hui.
Il vivait une époque troublée : sa génération avait traversé l’enfer de la Grande Guerre, et a dû faire face à l’horreur encore plus titanesque de la Seconde Guerre mondiale. Quand il écrit ces lignes au début du Seigneur des Anneaux, on est en 1939 :

« I wish it need not have happened in my time, » said Frodo.
« So do I, » said Gandalf, « and so do all who live to see such times. »
Comme tous ceux qui vivent de pareils temps, en effet. Et nous sommes aujourd’hui en train de regarder de loin (et pourtant de si près) un autre empire ténébreux qui fait de la guerre de conquête sa raison d’être : la Russie de Poutine. C’est clair aujourd’hui pour tous ceux qui veulent bien le voir.
Parlons franc. Il y a deux ans, lors de l’invasion initiale de l’Ukraine, l’Europe et les USA ont calculé que Kiev tomberait à brève échéance. Ce n’était pas illogique, tout bien considéré. Puis, lorsqu’on a vu que le pays résistait, que l’avance russe marquait le pas, ils ont fait une autre erreur d’estimation en pensant que Poutine renoncerait et se contenterait de quelques gains territoriaux dans l’est et le sud, de quoi soutenir sa fiction sur la « libération » des populations russophones tout en limitant les dégâts pour lui. Là aussi, c’était un calcul rationnel. C’est ce que ferait un dirigeant qui dépend peu ou prou d’une opinion publique.
Mais pour un dictateur, comme pour un gangster, reculer est un aveu de faiblesse, chose mortelle pour lui. On n’est pas en démocratie à Moscou, même imparfaite. La vie des Russes et leur niveau économique est d’ailleurs bien la dernière chose qui importe à cet ancien apparatchik soviétique, ce n’est que trop clair aujourd’hui. Il a choisi la fuite en avant, avec l’aide d’autres seigneurs de la guerre en Iran, en Corée du Nord… Des pays déjà plus ou moins en autarcie et qui n’ont pas à changer grand-chose chez eux pour se transformer en relais de l’entreprise de dépeçage russe.
Est-ce que Poutine croit à sa propre propagande ? À la limite, peu importe, car il a, comme Sauron dans le livre, des relais pour la faire avaler aux peuples qu’il entend conquérir.
La lucidité de Tolkien l’avait vu aussi : la menace du Seigneur ténébreux est toujours hybride, et il faut faire attention à ceux qui, dans notre propre pays, renversent l’ordre des faits, parlent de l’agresseur comme d’une victime et qui, quand ils disent « paix », veulent en fait dire soumission…

« Oui, nous aurons la paix quand vous et toutes vos œuvres auront péri. (…) Vous êtes un menteur, Saroumane, un corrupteur du cœur humain. Vous me tendez la main, et je ne vois qu’un doigt de la serre de Mordor. Cruel et froid ! »
Plusieurs dirigeants occidentaux récemment, dont le président français, ont visiblement désormais un avis similaire. On ne peut que s’en féliciter. Le danger n’est pas moindre, mais au moins on y fera face les yeux ouverts.