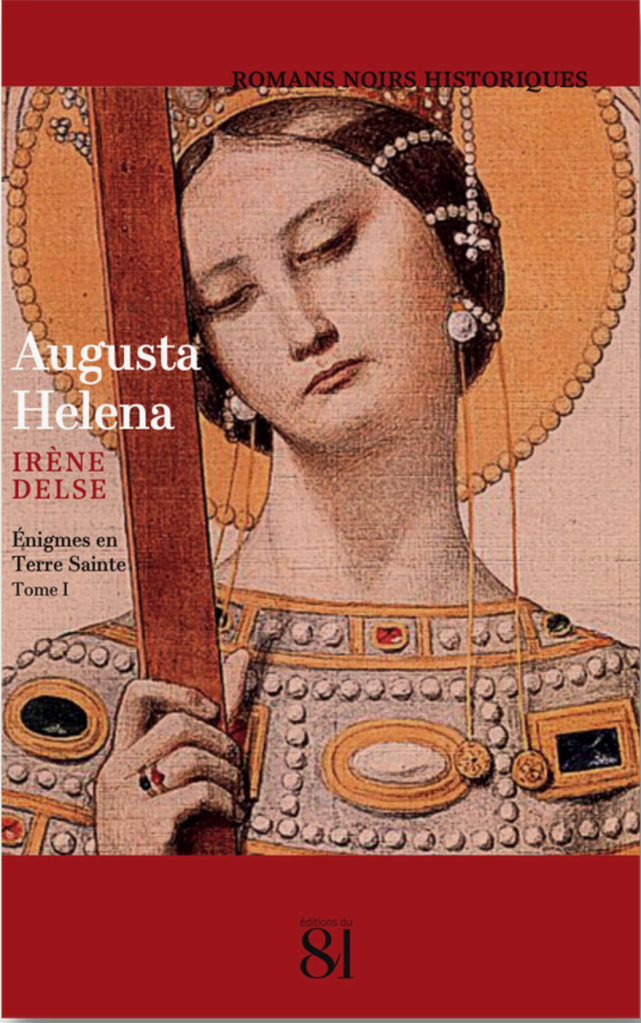J’aime bien aller chercher dans la littérature des parallèles aux thèmes de l’actualité, même éphémères. En ce moment, on parle beaucoup des EHPAD, pour déplorer qu’on y « abandonne » les vieillards, qu’on les y traite comme du bétail. Il n’est pas difficile de détecter le malaise, voire la culpabilité obscure de beaucoup de commentateurs.
C’est bien pratique pour tout le monde, après tout, quand les personnes très âgées, en situation de dépendance, peuvent être prises en charge par des gens dont c’est le métier. Combien de familles, surtout dans un pays comme le nôtre où la majorité des femmes a un emploi, ont le temps et la capacité à le faire ? Aide-soignants ou assistants de vie quotidienne, c’est prenant. Ceux qui prétendent le contraire, qui veulent faire croire que « c’était mieux avant », quand les gens se débrouillaient en famille, sont au mieux ignorants de l’histoire, au pire de très mauvaise foi.
Le thème des vieux misérables, négligés, voire maltraités est commun dans la littérature. Voyez la façon dont les filles du Père Goriot exploitent puis rejettent un père trop naïf. Ou la lente déchéance du père Mabeuf dans Les Misérables de Hugo. Le même roman brosse aussi la portrait de vieilles mendiantes qui cherchent à manger dans les tas d’ordures (c’était avant l’invention des poubelles). Dans Rabelais, un épithète fréquent des vieilles est « orde », c’est-à-dire sale. Incapables de prendre soin d’elles-mêmes, par pauvreté ou perte des facultés, elles sont néanmoins traitées comme des figures comiques. C’est dire combien l’idée de déchéance physique et sociale des vieilles femmes devait aller de soi…
Vous me direz que c’est un peu loin ? Voire. Il y a dans le Trésor des Contes d’Henri Pourrat (collectés en Auvergne à partir de 1911) une petite histoire intitulée « L’auge », que je voudrais raconter ici.
C’est l’histoire d’un brave homme, père de famille, qui a recueilli son vieux père sous son toit. Le soir, toute la famille mange la soupe autour de la table, du grand-père au petit fils. Mais le pauvre grand-père radote, on ne comprend pas ce qu’il dit parce qu’il n’a plus de dents, et comme ses mains tremblent constamment, il fait tomber la moitié de sa soupe en la portant à la bouche.
L’homme a un peu honte de son vieux père. Et surtout, sa femme (à qui il revient de nettoyer tout ça) en a plus qu’assez. Un jour, elle entreprend son mari : fais quelque chose pour le vieux, c’est insupportable de l’avoir à trembloter, crachoter et bavoter à table !
L’homme, pas très courageux ni très malin, comme souvent dans ce genre de contes, s’incline. Au lieu de manger la soupe à table, dans une assiette, le vieux aura désormais une auge dans un coin de la cuisine. Il n’aura qu’à se pencher dessus pour manger comme un animal. Le vieillard, qui n’est pas complètement sénile, comprend bien, mais que peut-il faire ?
La famille continue ainsi un moment, dans une paix apparente. La femme surtout n’est pas mécontente de ne plus avoir à tout éponger derrière le vieux, ni à écouter ses bafouillis. L’homme a acheté la tranquillité dans son ménage en mettant à l’écart son propre père. Les enfants, bien élevés, ne disent rien. Ils sont trop jeunes pour avoir voix au chapitre. Sauf…
Sauf le jeune fils, qui n’a pas dix ans mais qui est déjà habile à tailler des objets en bois. Et le voilà qui se met à travailler à quelque chose de nouveau.
— Tiens, lui dit son père ? Que fais-tu de beau ?
— Je fais une auge, papa, pour toi, quand tu seras vieux.
Évidemment, la vérité sortie de la bouche de l’enfant fait faire un retour sur lui-même à notre homme. Il engueule copieusement sa femme, met au rebut l’auge et installe à nouveau son vieux père à la table commune. Tout est bien (dans le conte) qui finit bien.
L’histoire ne dit pas si l’une des filles de la famille n’a pas été chargée de donner à manger au grand-père à la cuillère, ou autre arrangement. Aujourd’hui, on parlerait d’auxiliaires de vie. Qui sont encore souvent des femmes, mais qui sont payées pour cela. Une différence pas du tout négligeable, certes.