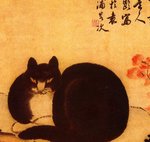Placer un récit à une autre époque, ce n’est pas seulement une question de détails matériels à vérifier, et pourtant ! Combien de romans par ailleurs palpitants laissent une impression désagréable au final parce qu’ils se sont plantés sur un point fondamental pour l’intrigue, ou même sur un détail périphérique mais qui change tout le climat de l’œuvre ?
Je pense par exemple à un roman policier de John Maddox Roberts (de la série SPQR) où la résolution de l’intrigue exigeait que l’on fasse la différence entre les chevaux des Romains, qui étaient ferrés, et ceux des Maurétaniens, qui ne l’étaient pas. Problème : à l’époque en question (fin de la République), les Romains non plus n’utilisaient pas de fers à chevaux. (Ils utilisaient des hipposandales, ou fers amovibles, à titre thérapeutique, pour protéger un pied abîmé, mais pas le fer à cheval proprement dit, qui date au plus tôt de l’époque byzantine.)
Ou bien que l’on songe aux libertés que prend Alexandre Dumas avec la chronologie du règne de Louis XIII dans ses Trois Mousquetaires : le véritable d’Artagnan devait avoir 12 ou 13 ans en 1625, au début du roman. Certes, on peut arguer que le héros ne fait qu’emprunter son nom au Gascon historique, que c’est un double romanesque… Reste que c’est une gaffe dans la construction du roman.
Mais tout cela, au fond, n’est que la partie émergée de l’iceberg, les aspects les plus faciles à vérifier et à appliquer quand on cherche à immerger un récit dans une époque historique, le nom des rois, reines, papes et autres dirigeants, le niveau technologique, les habits, les armes, même la botanique (pas de tomate en Europe avant Christophe Colomb…), tout cela demande simplement de la minutie et un accès à une bonne bibliothèque, ne serait-ce qu’en ligne. Là où cela devient une autre paire de manches, c’est si on veut essayer de reconstituer aussi l’univers mental d’une autre époque, sa représentation du monde et d’elle-même.
Pour en revenir aux Romains, par exemple, les hipposandales sont un indice intéressant à la fois du niveau atteint dans l’Antiquité par l’art vétérinaire, mais aussi de l’importance économique et militaire des chevaux et mules. La présence de mulomedici (médecins pour mules, littéralement) aux armées et dans les relais de poste nous en dit long également sur la capacité de l’Empire Romain à organiser et planifier.
Cet exemple nous montre un aspect du monde romain qui n’est pas si éloigné du nôtre : bureaucratie, techniciens spécialistes… Mais si on s’intéresse à la médecine proprement dite, on risque d’avoir des surprises.
Qu’est-ce qu’une maladie, par exemple ? Nous avons l’habitude de dire que telle infection est causée par tel agent pathogène, bactérie, virus, parasite, etc. Ou bien on relie un dérèglement physiologique à une anomalie génétique (certaines formes de diabète, par exemple) ou à un problème lié à la vie quotidienne (ainsi du surpoids et de l’obésité) du patient. On pense en terme de causes matérielles, avec des outils mentaux rarement antérieurs au XIXe siècle : même la définitions des tissus comme unités anatomiques date des années 1800, avec Xavier Bichat. La vaccination se développe à la toute fin du XVIIIe siècle avec Jenner. La médecine expérimentale de Claude Bernard date du milieu du XIXe siècle, et la théorie des germes a peu à peu accumulé des arguments empiriques (notamment les observations au compte-fils puis au microscope, à partir de 1700) jusqu’aux travaux définitifs de Pasteur. Quant à la génétique, malgré les bases posées par Mendel dans les années 1860, elle est née et s’est développée au XXe siècle.
Si on essaie de se placer en esprit à une époque antérieure au XXe siècle, c’est toute la relation de l’être humain aux maladies qu’il faut repenser. Imaginons à nouveau un récit placé à l’époque romaine : si un personnage tombe malade, comment raconter cela ? Si je parle de germes et de pathogènes, ou même si je mentionne la circulation sanguine, je sors de l’univers mental de l’époque, et donc je trahis l’esprit de mon récit. Mais si je reprends le vocabulaire des médecins de l’époque, avec ses miasmes et ses humeurs, cela donne vite un discours ridicule, du genre croqué par Molière dans son Malade imaginaire.
Il n’y a pas de solution parfaite ni universelle. En écrivant Augusta Helena, mon roman historique sur Hélène, mère de l’empereur Constantin, j’ai opté pour n’utiliser qu’au minimum le jargon médical antique, même en faisant parler un médecin. Mais je n’ai pas pour autant employé de concepts médicaux trop récents. Ainsi pour la question du paludisme, qui était une maladie endémique de la région de Rome, à cause des Marais Pontins et de leurs moustiques : on faisait dès l’Antiquité le lien entre les marécages et des maladies fébriles pouvant entraîner la mort, mais on pensait que c’était quelque chose dans l’air (d’où le nom italien de la maladie, malaria). Le rôle des moustiques comme vecteur est resté mystérieux jusqu’aux travaux de Carlos Finlay à Cuba en 1881. Dans mon roman, je n’ai mentionné les moustiques des marais du Latium que comme bestioles agaçantes, sans parler du lien avec la fièvre récurrente qui mine l’un de mes personnages et finit par l’emporter. Mais j’ai pris soin de citer les moustiques. (Par parenthèse, les Marais Pontins furent une plaie de Rome jusqu’aux années 1930, quand les grands travaux de Mussolini les ont asséchés et permis d’y faire de l’agriculture.)
La terminologie est donc déjà un point délicat, s’agissant des maladies, de leurs causes et de leurs remèdes. Mais plus encore, en écrivant un récit historique qui se veut réaliste, on ne peut pas ne pas prendre en comptes les réalités humaines d’une époque où la mort fauchait bien plus souvent, et aussi bien plus tôt. Avant l’introduction des vaccins, en Europe, un enfant sur deux n’atteignait pas l’âge adulte. Est-ce que mes personnages seront plus fatalistes face à ce genre de choses ? Probablement. Mais c’est difficile à faire passer pour des lecteurs modernes.
Il y a ainsi un passage dans Tous les Accidents, mon roman situé à l’époque de la Révolution et de l’Empire, qui a un peu perturbé les béta-lecteurs, et non sans raison : la mort d’un nouveau-né. Ce qui est pour nous l’horreur absolue, le drame des drames, était alors quasiment un passage obligé pour les familles. Ce qui m’intéressait, c’était justement comment réagissaient les survivants. J’ai une grand-mère qui a perdu son premier fils en bas âge à cause d’un accident et en a terriblement souffert, mais son éducation et son milieu social n’étaient pas favorables à l’extériorisation des sentiments. Ce qu’elle en disait, quand elle disait quelque chose, c’était : « Il faut porter sa croix. » Une philosophie terrible, si on y songe.