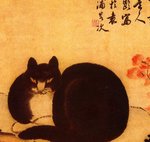Main du crime… selon Dame Agatha ! (Source : Wikimedia)
Il y a des romans que je peux relire dix fois, et toujours y trouver du grain à moudre pour mes méninges. Dans le cas de Cartes sur table, d’Agatha Christie, c’est moins l’intrigue qui me retient que la leçon d’écriture contenue dans ces modestes 240 pages.
L’idée du roman avait germé dans la tête de l’auteure, semble-t-il, lors de précédentes aventures de son détective fétiche, le très cérébral Hercule Poirot :
« Imaginons quatre personnes autour d’une table de bridge et une cinquième, l’outsider, assise devant la cheminée. À la fin de la soirée, l’outsider est retrouvé mort. L’un des quatre joueurs s’est levé et l’a tué quand c’était son tour de faire le mort. Les trois autres, absorbés par la partie, n’ont rien vu. Voilà qui serait un crime pour vous ! Lequel des quatre l’a tué ? »
— Hercule Poirot au capitaine Hastings, A.B.C. contre Poirot
L’absence totale d’indices matériels, l’obligation de se pencher de très près sur la psychologie des personnages, telle que la révèle leur façon de jouer au bridge, donne à cette enquête une saveur et une tonalité bien particulière, même au sein de l’œuvre d’Agatha Christie. Poirot est au sommet de son art, et Christie aussi. Elle s’amuse même à mettre en scène un second détective, une certaine Ariadne Oliver, auteure de romans policiers, qui lui permet de se moquer gentiment d’elle-même – et des autres praticiens du genre !
C’est que la façon dont on mène l’enquête, dans un roman d’ Agatha Christie, et surtout la façon dont le limier raconte sa quête au public, ont beaucoup à voir avec la façon dont la romancière peut créer des personnages auxquels nous, lectrices et lecteurs, avons envie de croire.
Hercule Poirot, dans le petit extrait ci-dessus, l’illustre bien : sa démarche est avant tout narrative, elle consiste à prendre les personnages les uns après les autres et à suivre leurs faits et gestes, mais surtout leurs émotions. Qui est l’homme assassiné ? Quelles relations avait-il avec chacun des suspects ? Pourquoi pouvait-on le haïr ou le craindre ? Et qui, parmi les suspects, avait à la fois la motivation et les moyens, psychologiques autant que matériels, de tuer ?
Or ce sont des questions que toute personne qui écrit un roman pourrait reprendre à son compte : qu’est-ce qui motive tel personnage pour agir ou ne pas agir à tel moment ? Quels sont les ressorts de sa personnalité ? Quels traits de son caractère le rendent susceptible de tomber dans un piège, ou au contraire de le déjouer ? Et comment les rendre intelligibles au lecteur ?
Une des maximes énoncée par Hercule Poirot dans ce roman est que : « Tout le monde est capable de commettre un crime, mais pas nécessairement ce crime-là. » (Un autre des personnages fétiches de l’auteure, Miss Marple, dira à peu près la même chose à ce sujet.)
C’est ainsi que Poirot nous entraîne à sa suite dans un tableau psychologique des quatre principaux suspects, observant leurs réactions devant le stress d’une accusation, scrutant les mots qu’ils emploient, leurs goûts, leurs aversions, remontant dans leur passé aussi pour détecter de possibles crimes qu’ils auraient déjà commis… Et tout du long, c’est le travail de création des personnages qui est mis à nu : qui sont-ils, qu’est-ce qui les fait courir, quels sont leurs secrets coupables et les points de faiblesse de leur personnalité…
Un exercice auquel se livre Poirot est particulièrement éclairant : il demande à chacun des suspects, à son tour, de décrire la scène du crime, sans leur expliquer pourquoi. Mais à nous, via la discussion qu’il a ensuite avec des comparses, il explique que cela lui permet de voir par les yeux des suspects, de savoir ce qu’ils considèrent comme important ou au contraire négligeable, selon la façon dont ils en parlent. Ainsi, on voit qui parmi les suspects remarque des objets précieux dans le salon où a eu lieu le meurtre (ouvrant la question de la cupidité comme mobile), et qui au contraire ne s’intéresse nullement à ce bric à brac. Cela permet même à Poirot de distinguer, parmi deux dames en apparence aisées, laquelle est obligé de gagner sa vie comme demoiselle de compagnie : par exemple, elle remarque dans le salon les fleurs dont l’eau a besoin d’être changée, mais pas les autres vases.
Ces petits exercices permettent à Poirot de cerner la personnalité des suspects : l’une est surtout portée à voler, mais pourrait tuer pour éviter d’être découvert, dans un moment de panique ; un autre n’a été coupable que d’homicide involontaire ; un troisième est un assassin invétéré et sans scrupules, qui tue avec aplomb pour protéger sa surface sociale de notable respecté…
Bien sûr, ces « observations » de Poirot sont le versant fictionnel du travail de création de personnages auquel se livre la romancière afin que nous, le public, ayions l’impression de voir de vrais êtres vivants évoluer devant nos yeux, pas des silhouettes de carton interchangeables pour les besoins de l’intrigue. Chacun a un passé, des passions, des faiblesses, que l’on va découvrir peu à peu au fil des interactions des uns et des autres. Ils agissent pour des motifs bien précis – et même si ce n’est pas toujours clair dans la tête du personnage, il faut que ce le soit pour l’auteur !
Bref, on pourrait paraphraser ainsi la formule de l’homme aux « petites cellules grises » : Tous les personnages de roman sont capables d’agir, mais pas nécessairement d’agir de cette façon-là.
Et quand la vraisemblance psychologique est en défaut parce que vous avez poussé un personnage, pour les besoins de l’intrigue, plus loin qu’il ou elle ne l’aurait osé, il y a de grandes chances pour que ce soit l’intrigue qui ait tort. La demoiselle de compagnie timorée qui escamote les bijoux de sa riche patronne puis l’empoisonne en douce en remplaçant le contenu d’une bouteille de sirop, n’est pas capable de commettre le même genre de crime qu’un homme qui va tranquillement planter un poignard dans le cœur de son ennemi, au milieu d’un salon, en profitant de ce que tous le monde et absorbé par le bridge, puis revient prendre son tour aux cartes comme si de rien n’avait été. Et si l’intrigue nécessite le second type de crime, alors, de deux choses l’une : ou bien il faut changer de personnage. Ou bien il faut changer l’intrigue.