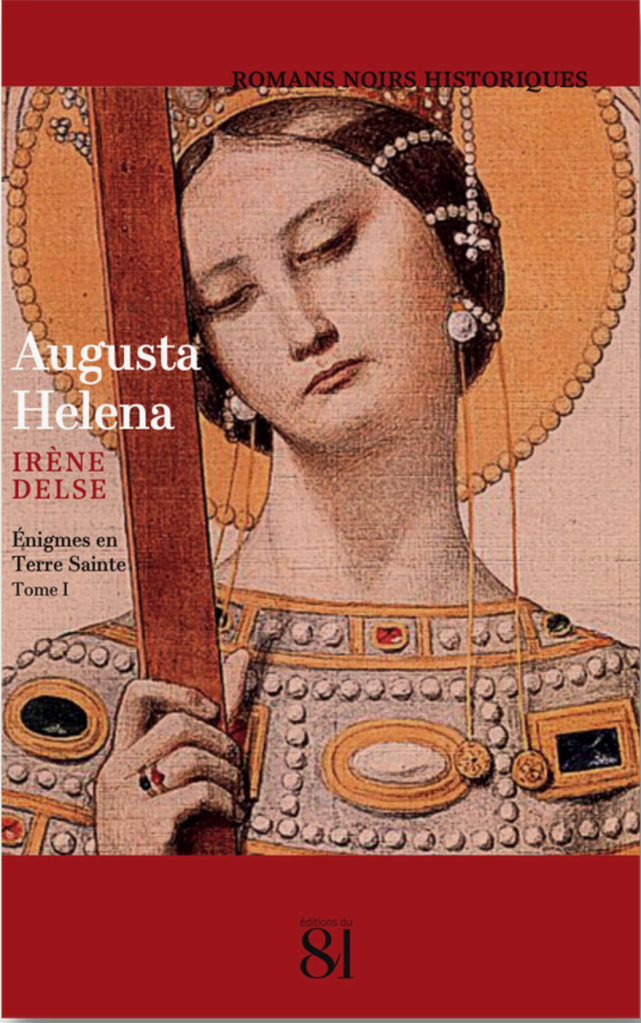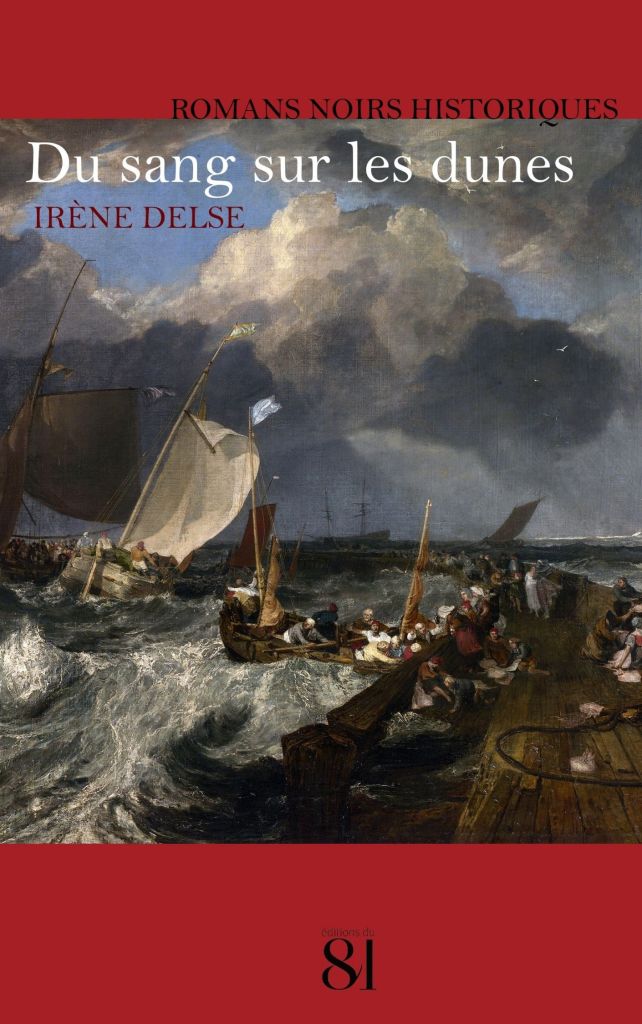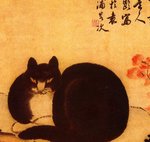Non, il ne s’agit pas des Men in Black de la mythologie extraterrestre ! Mais de ce qui peut arriver à un roman pendant sa rédaction.
Le concept de « l’homme en noir » (the man in black), ou « l’homme en noir dans le coin », provient du site personnel de Jane Fancher et de ses réflexions sur l’écriture, mais le terme lui-même a été créé par C.J. Cherryh.
Je traduis dans les grandes lignes :
« Dans l’écriture d’un roman, l’auteur rencontre souvent sur son chemin ce type de personnage : l’homme en noir, dans un coin de l’auberge, qui semble là simplement pour donner un coup de main ponctuel au héros. Mais avant longtemps, il aura fait changer l’intrigue de cap et menacera de coloniser tout le roman ! À ce moment, l’auteur n’a plus guère de choix : éliminer l’intrus, l’envoyer sur une autre trajectoire (c’est-à-dire lui consacrer une œuvre à part), ou céder à l’inévitable et lui abandonner le roman. » J. Fancher
Le nom vient d’un exemple fameux : Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux, que l’on voit apparaître littéralement comme un homme mystérieux habillé de couleurs sombres, dans le coin d’une auberge. Les carnets de J.R.R. Tolkien, publiés dans L’Histoire de la Terre du Milieu (édité par Christopher Tolkien) montrent bien que l’irruption de ce personnage et de tout l’arrière-plan qu’il implique (les Nûmenoriens, Gondor, Arwen…) n’étaient pas prémédités. Au départ, Frodo et ses amis devaient juste rencontrer un Hobbit (eh oui !) mystérieux, « Grand-Pas », qui les mettrait sur la voie pour l’étape suivante de leur voyage. Mais le personnage dépassa bientôt cette dimension utilitaire. Tolkien, sentant les possibilités de ce Grand-Pas, lui trouva un nom et une histoire plus épiques, et le monde du Seigneur des Anneaux, tout comme la trajectoire du roman, en fut changé.

Et moi, ai-je rencontré un jour cet « homme en noir », durant la rédaction de L’Héritier du Tigre ? Mais oui. D’où croyez-vous que vienne Tzennkald ? Lui aussi s’est imposé à petit bruit, pour devenir bien vite incontournable. Avec cependant une différence : je n’ai pas laissé le roman se réorganiser autour du nouveau-venu ! Mais la solution retenue a pu frustrer certains lecteurs.
Je n’en dis pas plus : le texte est disponible en lecture sur Vivlio Stories. À découvrir !


Attention : un Homme en noir peut aussi bien être une femme. En écrivant les aventures d’Hélène, mon « Indiana Jane du IVe siècle », j’ai trouvé sur mon chemin une certaine mystérieuse jeune femme que je n’ai pas eu le cœur d’éloigner après qu’elle ait eu rempli le bref rôle qu’elle était censée jouer au début du récit. Le résultat est un roman plus long, mais aussi plus riche, je pense. À lire dans Augusta Helena, aux éditions du 81.

Et puis il y a le cas d’un roman que j’ai écrit en 2019, qui cette fois qui se déroule pendant la Révolution française et l’Empire. Retour à un homme, littéralement en noir pour certains épisodes, et dont la destinée croise à différentes reprises celle de mon héroïne, et qui me permet d’explorer d’autres facettes d’une époque complexe, dramatique, riche en personnages équivoques, ni tout blancs ni tout noirs. C’est je crois Siéyès qui, à la question : « Qu’avez-vous fait pendant la Révolution ? » répondait : « J’ai vécu. » Mon nouvel Homme en noir pourrait contresigner sans hésitation.
Mais dans ce cas, j’ai cédé : je lui ai donné sa propre série… À découvrir dans les enquêtes du capitaine Dargent, aux éditions du 81 ! Dernier volume paru : Coup de froid sur Amsterdam, dans toutes les bonnes librairies.