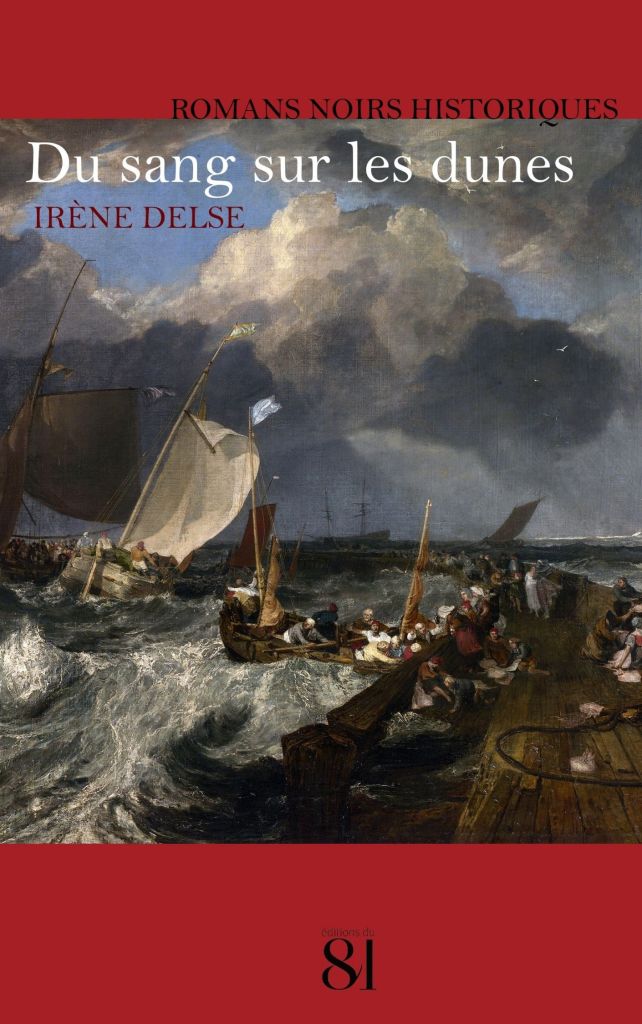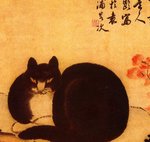En attendant le mois d’octobre et la parution de mon prochain roman, Mort d’une Merveilleuse, j’aimerais me pencher sur les antécédents de la littérature policière telle que nous la connaissons de nos jours, et explorer les récits de détectives issus des Mille et une nuits, de la Chine ancienne, ou pourquoi pas de la Bible.
Car l’une des plus anciennes enquêtes policières de la littérature mondiale se trouve au livre de Daniel, dans l’épisode fameux de Suzanne et les vieillards. Le passage est lui-même assez tardif dans l’écriture de la Bible, puisqu’il est rédigé en grec, donc probablement à l’époque hellénistique, vers le IIIe siècle avant J.-C., lorsque la Palestine était gouvernée par les rois séleucides, successeurs d’Alexandre le Grand.
L’histoire est simple, frappante, et vivement racontée. La protagoniste, Suzanne, est une jeune israélite aussi belle que vertueuse, qui épouse un homme riche et respecté. D’autres notables fréquentent sa maison, dont deux doyens faisant partie des chefs de la communauté juive locale. Mais les deux vieillards sont pris d’un désir coupable pour la jeune femme et se cachent dans le jardin pour l’épier quand elle prend son bain, puis essaient de la convaincre de coucher avec eux, en la menaçant de l’accuser d’adultère si elle appelle au secours. Suzanne est au désespoir, mais appelle quand même, préférant mourir sans avoir péché. Devant le mari et les serviteurs qui accourent, les deux séducteurs jouent la comédie, prétendant que c’est Suzanne qui a tenté de les induire en tentation. Son cas est clair : elle est adultère, elle doit être mise à mort.
Mais tandis qu’on la mène au supplice, elle croise le jeune Daniel, un adolescent inspiré par l’Esprit Saint. Il s’écrie qu’elle est innocente, et se met à l’œuvre pour le prouver. Pour cela, il sépare les deux accusateurs et les interroge chacun de son côté : « Sous quel arbre du jardin, demande-t-il, te tenais-tu lorsque tu as vu Suzanne ? » L’un répond : « Un lentisque », l’autre : « Un chêne vert. » Oups ! Ils se sont coupés, ont révélé que leur histoire était un mensonge ! Daniel le fait constater à l’assistance et proclame l’innocence de Suzanne, et la culpabilité de ses accusateurs.
Le thème de Suzanne a inspiré bien sûr les arts, surtout comme prétexte à dépeindre des nudités, ce qui n’était pas évident dans le monde chrétien. Le cadre biblique faisait passer beaucoup de choses. L’histoire elle-même et son motif d’innocence bafouée, puis reconnue, a aussi eu une longue postérité littéraire. Mais il faudra attendre des siècles pour qu’un personnage tel que celui de Daniel soit de nouveau mis en scène. En fait, ce contre-interrogatoire serait parfaitement à sa place dans un film de prétoire contemporain.
Il faut dire que le Daniel que dépeint la partie deutérocanonique du livre, celle écrite en grec, est par certains aspects plus proche d’un philosophe (voire un investigateur sceptique sur le mode de James Randi) que d’un prophète ou interprète des songes. En plus de prouver l’innocence de Suzanne, le jeune Daniel est le héros d’une confrontation avec le roi de Babylone où il prouve par d’ingénieuses expériences que les prêtres de Bel trompent le roi en lui faisant croire qu’une statue contient la présence réelle du dieu (« Bel et le dragon », Daniel, chap. 14). Chaque soir, de la nourriture est placée dans le temple, et le lendemain elle a disparu : c’est que le dieu l’a consommée, disent les prêtres. Mais Daniel montre que ce sont eux, en fait, qui s’introduisent nuitamment dans la chambre de la statue et s’empiffrent des mets déposés en offrande.
Cette ingéniosité et cette capacité à remettre en cause l’évidence apparente seront des éléments clefs de la future littéraire policière. Plus que Dupin ou Holmes, c’est Daniel qui devrait être considéré comme le prototype des détectives amateurs.