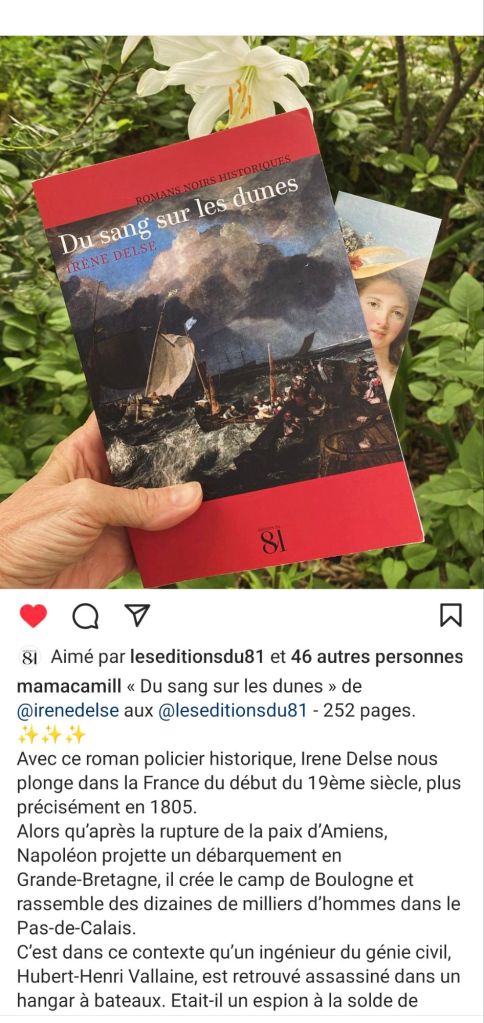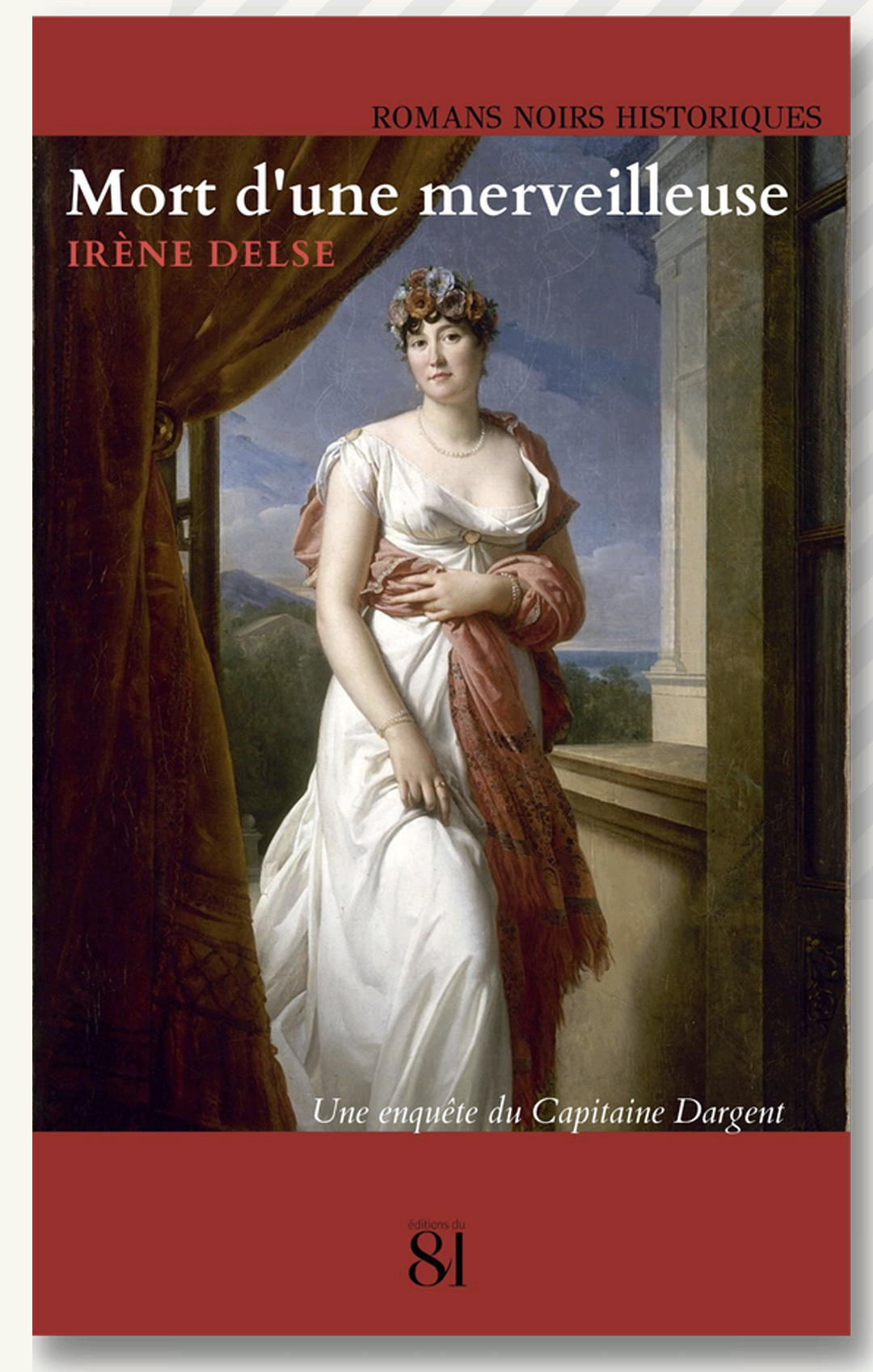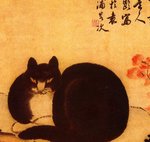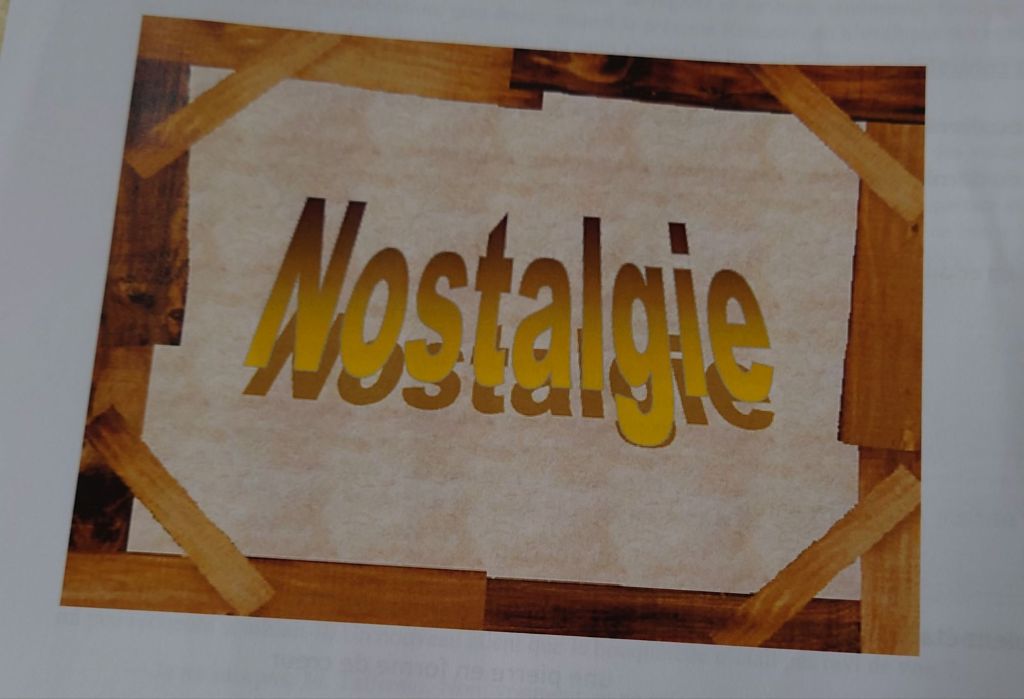
Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie du monde de leur enfance, de leur adolescence, ou du moins la nostalgie d’une version mythifiée de cette époque.
Je ne les suivrai pas dans l’adoration béate du monde d’avant. J’ai mes souvenirs.
Et je ne parle pas seulement des bonds considérables faits en médecine, en informatique, dans toutes les sciences et les technologies, en fait. Même si c’est important. Je vis actuellement une vie normale, malgré une maladie chronique, grâce à un médicament fabriqué par génie génétique. J’ai l’information du monde entier au bout des doigts, dans un appareil qui tient dans la poche. Et ainsi de suite.
Je pourrais parler aussi des gains faits au niveau européen : la possibilité d’aller et venir sans contrainte sur tout le continent, les opportunités pour les études, le travail. Ou les réformes en France qui ont brisé le cycle infernal du chômage, même s’il y a encore à faire pour arriver au plein emploi. Mais déjà ce n’est plus la même désespérance pour les jeunes : ils ont un vrai avenir, souvent via l’apprentissage ou l’alternance. Et les créateurs d’entreprises aussi ont le vent en poupe. J’ai des amis dont les startups marchent, j’y ai même investi moi-même à ma petite échelle.
Et tant d’autres choses. La transformation de l’Europe, encore timide mais sur les rails, d’un simple vaste marché à un espace commun de résistance à l’agression extérieure, tant au terrorisme et au crime organisé avec Europol que via l’aide à l’Ukraine et le développement d’industries de défense. L’idée de souveraineté européenne, lancée par la France, fait son chemin.
Non, s’il y a un point sur lequel les gens disent souvent « c’était mieux avant », c’est sur les sujets de sociétés. L’école, l’intégration… Mais là aussi, j’ai mes souvenirs.
Dans le collège où j’allais en 1980, les enfants de familles noires et maghrébines étaient littéralement relégués dans une classe à part. Une politique de la directrice, qui n’avait pas été alors sanctionnée par l’Éducation nationale. Ça n’a commencé à changer que quand elle est partie à la retraite.
Demandez-vous ensuite pourquoi tant de personnes issues de l’immigration ont « la haine », avec ce genre de souvenirs dans leur passé ? Ou avec le mépris que certains politiciens propres sur eux, portant cravate ou cheveux blonds, expriment encore pour des questions de prénoms ou de double nationalité ?
J’ai dans mon entourage des couples binationaux, justement. Et ce genre de politiques veulent en faire des citoyens de seconde zone pour une question d’origine, de faciès, de couleur de peau, de religion. C’est explicitement prévu : suppression du droit du sol, donc redéfinition de ce qu’est un Français sur des bases raciales.
Si on veut susciter encore plus de haine, de troubles, de rejet de la République, c’est sur la bonne voie…
Mais d’un autre côté, je ne me résigne pas non plus à l’autre extrême, celui qui ne veut voir dans des gens comme ces amis et parents que des « racisés », des « indigènes » fondamentalement différent, au final, des autres citoyens, avec des droits et devoirs différents.
Ces politiciens qui se disent progressistes mais qui excusent l’antisémitisme ou l’homophobie quand ceux qui la profèrent sont musulmans. Ceux mettent la lutte contre « l’islamophobie » (un concept utilisé par les islamistes) au même rang que celle contre le racisme, ce qui revient à exclure toute critique ou même tout discours un peu divergent sur l’islam. Les membres de Charlie Hebdo, Samuel Paty, Dominique Bernard ont été tués au nom de cette accusation d’islamophobie. Salman Rushdie, pourtant lui-même issu de cette culture, vit depuis trente ans sous protection policière et a failli récemment y laisser sa peau.
Je n’ai pas envie de laisser l’école ouverte à ceux qui l’utilisent comme lieu de prosélytisme, avec revendication de vêtements « islamiques », de salles de prière, de non mixité, ou encore la contestation des cours sur l’évolution, le système solaire, l’éducation sexuelle, la Shoah…
Je ne peux pas ne pas penser à cette gamine, fille d’un couple d’amis franco-tunisiens, qui a dû quitter l’école publique pour une privée parce qu’elle était harcelée, simplement parce qu’elle voulait travailler comme une élève normale.
L’extrême-droite la rejette et la méprise pour son nom arabe et pour la religion de son père, l’extrême-gauche ne voit en elle qu’une arabe et une musulmane, et laisserait les barbus définir ce qu’elle doit être. Sinistre dans un cas comme dans l’autre. Et si quelque chose pouvait donner espoir, c’est bien le sérieux accordé par l’actuel Premier ministre, Gabriel Attal, à ce genre de questions.
Alors non, le monde actuel n’est pas parfait, il y a bien des choses à améliorer, mais ce n’est pas en instaurant une ségrégation raciale, ni en cédant aux islamistes, qu’on bâtira une société vivable. Ni maintenant ni jamais.