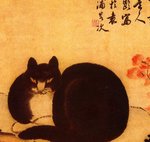J’ai des goûts assez éclectiques en matière de littérature, mais ça ne les empêche pas d’être tranchés. Ainsi, quand un roman historique ne parvient pas à m’embarquer dans son univers, ou pire quand quelque chose m’en éjecte en cours de lecture, je tends à ne pas donner une seconde chance à l’auteur. Désolée. Ou pas vraiment.
Mais au fait, quel genre de choses me sors de la lecture ?
D’abord, il y a les romans qui prétendent se passer dans l’Antiquité romaine, le Japon médiéval ou la France napoléonienne mais sont peuplés de gens du XXIe siècle avec des préoccupations du XXIe siècle. La raison première de lire des romans historiques, à mon sens, est de se dépayser. Il y a une très jolie citation de l’auteur britannique L. P. Hartley (1895-1972) : « The past is a foreign country; they do things differently there. » (Le passé est un pays différent ; les gens se conduisent différemment là-bas.)
Ce n’est pas juste que le passé était généralement plus brutal, la vie brève et pleine d’injustices et d’inégalités. C’est que la façon de voir le monde a évolué avec le temps, ainsi que la façon dont les gens se voyaient eux-mêmes, les valeurs qui leur servaient de points de repère, etc. Ainsi, l’idée d’avoir une vie privée, de protéger son intimité, s’est développée en Europe au cours du XVIIIe siècle. On voit apparaître de façon concomitante le mobilier qui permet cette intimité (la chaise percée étant désormais masquée dans un petit cabinet, nom qui est resté), les genres littéraires qui témoignent d’un souci de quant-à-soi (roman « sensible », de Clarisse Harlowe à La Nouvelle Héloïse, qui offre une plongée dans le for intérieur de l’héroïne) et des traités philosophique sur les droits de l’individu, y compris le droit au bonheur.
Autre chose dont on a du mal à se rendre compte aujourd’hui, c’est l’importance du calendrier agricole même pour la vie des citoyens. Il ne faut pas oublier qu’avant la Révolution industrielle, 80% de la population active travaillait aux champs (et cette population incluait une bonne partie des enfants, dès qu’ils étaient assez grands pour désherber ou effrayer les oiseaux). Même si le roman ne s’occupe pas d’agriculture, il faut qu’on sente ces réalités. Les aliments disponibles à telle ou telle partie de l’année, par exemple, ou les paysages traversés.
Mais il y a plus subtil : en lisant Balzac (Illusions perdues, 1837-43), on rencontre le petit fait suivant : de nombreuses loges de théâtre et d’opéra étaient disponibles de juin à septembre parce que leurs titulaires, riches propriétaires terriens, s’absentaient de Paris pour surveiller moissons et vendanges dans leurs domaines (Deuxième partie, « Un grand homme de province à Paris »).
C’est le genre de détail qu’on n’invente pas mais qu’on découvre par la fréquentation des sources, en particulier des sources primaires : la littérature et autres documents d’époque. Dans le cas de Balzac, ces sources ne sont pas difficiles à trouver. Et nous avons une chance formidable en ce début de XXIe siècle : l’Internet et l’énorme effort de numérisation des documents, tant par les universités et bibliothèques (merci Gallica !) que par des collectifs comme le Projet Gutemberg. Les ouvrages dans le domaine public sont disponibles en quelques clics, souvent dans un choix de formats variés (texte, PDF, etc.) ainsi qu’une vaste quantité d’œuvres graphiques, de documents techniques, et de photos de monuments ou sites d’intérêt historique.
Ainsi, durant la rédaction du roman policier historique dont j’ai récemment parlé ici, j’ai utilisé plusieurs sources primaires de ce genre, notamment un recueil de rapports de police à Paris sous le Directoire qui est une mine d’informations sur la vie quotidienne, en partie celle des gens du peuple, mais aussi ce qui se passe dans les théâtres, les cafés, partout où l’opinion se fait et où le gouvernement veut la contrôler.
Un autre avantage de se plonger dans les textes et autres documents d’époques, c’est de donner une idée de la façon dont parlaient et pensaient les gens, ou au moins d’éviter de faire parler et agir trop évidemment nos ancêtres comme s’ils étaient des contemporains. Pensons à toutes les expressions imagées que nous utilisons quotidiennement mais qui sont liées à des concepts ou des événements historiquement datés. Parler d’un « pays satellite » (comme on le faisait au temps de Napoléon) par exemple aurait été impossible avant la généralisation du modèle copernicien au XVIIe siècle. D’un autre côté, il y a des mots qu’on ne comprend plus ou qui ont changé de sens, et il suffit de quelques décennies pour être dans l’erreur. Ainsi, un mot d’argot bien connu, « daron », signifiait « patron » ou « bourgeois » au tout début du XIXe siècle ; mais il avait pris le sens de « père » au moment où Hugo écrivait Les Misérables.
Il y a bien d’autres façons de trahir le passé qu’on veut recréer dans l’espace d’un roman. Le vocabulaire, les décors ne sont qu’un début. Le plus dur, c’est de faire vivre, agir et penser des gens qui avaient un univers mental et des valeurs bien différentes de nous.
Un travers commun, à ce que je peux voir dans ce qui se publie, c’est de peupler un roman historique uniquement de gens hauts en couleurs, plus grands que natures, extraordinaires dans l’héroïsme ou la cruauté, voire extrêmes en tout, y compris le boire et le manger. Or même Alexandre Dumas n’avait qu’un Porthos ou une Milady de Winter par roman, et c’est le contraste qui rend ces personnages-là mémorables. S’il n’y avait eu que des personnages de ce calibre dans le roman, comment aurait-on pu les apprécier ?
Ce qu’on oublie aussi facilement à propos du passé, c’est que les gens y vivaient une vie quotidienne, et que c’est le fond du tableau sur lequel se détachent les grands événements, guerres, révolutions, épidémies. Et si on n’a pas au moins évoqué la vie ordinaire, on n’éprouvera pas la pleine force de ses bouleversements.
(Aussi publié sur Substack.)