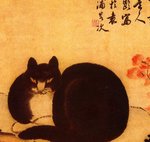J’en avais déjà parlé dans un article paru en 2016 dans la revue Prochoix : la liberté de religion et la liberté de conscience sont des idéaux communs de nos jours pour de nombreux pays, mais leur incarnation en France sous forme de laïcité n’est pas toujours comprise même par les gens de ce pays. Dommage, parce que l’histoire est instructive.
Remontons un peu au XVIIIe siècle. Ce qu’on appelle aujourd’hui le mouvement des Lumières s’est développé en réaction à l’absolutisme politique et religieux qui régnait alors dans quasiment tous les pays d’Europe. La liberté de conscience n’existait pas, surtout pour les gens du commun : les gens étaient censés avoir la même religion que leur roi, prince, duc ou autre seigneur. En Angleterre, on devait suivre la religion du roi d’Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, c’est le catholicisme qui était la religion officielle. Dans les divers États allemands, la religion pouvait être catholique ou protestante, mais c’était l’affaire des grands d’en décider. Les gens comme vous et moi n’avaient pas le choix, ils recevaient en naissant une religion en plus d’une langue, d’un rang social et de l’appartenance à un pays.
L’ouverture s’est faite peu à peu, par à-coups, et parfois dans la violence, comme durant la Révolution française ou les insurrections des Irlandais catholiques contre la domination anglo-protestante (au passage, c’est de là que vient la mention du catholicisme dans la chanson Les lacs du Connemara, qui a tant fait couler d’adrénaline récemment).
En Angleterre, les minorités religieuses (catholiques mais aussi juifs et divers groupes protestants dits « non conformistes », comme les méthodistes, et plus récemment les musulmans, hindous, etc.) se sont battues pour obtenir les mêmes droits que les Anglicans. Par exemple, elles ont obtenu que les mariages célébrés selon d’autres rites que la religion anglicane soient légaux, que les serments en justice puissent être prêtés sur un autre livre sacré que la Bible, etc. Au lieu de limiter le rôle de la religion du roi dans la vie publique et privée du pays, on a étendu aux autres religions les prérogatives jusqu’alors réservées aux anglicans.
Chez nous, au contraire, les partisans de liberté de conscience ont cherché à séparer le spirituel et le temporel pour créer dans la société civile un espace commun distinct des religions : lois de de 1789 émancipant les non-catholiques (jusque là, juifs, protestants et musulmans n’avaient pas d’état-civil et leurs droits étaient étroitement limités) et créant un état-civil distinct du registre des baptêmes et décès jusque là tenu par les curés ; utilisation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme charte éthique laïque ; lois de 1881 sur l’école primaire publique, laïque et obligatoire (cela ôtait aux églises un important levier d’action sur la société, et Jules Ferry comme ses « hussards noirs » en étaient bien conscients : il s’agissait d’arracher la jeunesse, pour une large part de son temps, à l’emprise du curé) ; enfin en 1905, loi portant séparation des églises et de l’État. Ainsi, être citoyenne ou citoyen ne nécessite aucune référence à la religion, ce qui a permis à des hommes et des femmes de toutes religions, voire sans religion, de s’engager pour le service de leur pays. C’est le sens de la phrase du comte de Clermont-Tonnerre, en 1789, à propos du statut des Juifs, alors débattu à la Convention : « En tant que peuple, aucun droit ; en tant que citoyens, tous les droits. »
C’est pour cela que l’on parle ici de liberté de conscience ici, pas juste de liberté de religion. Celle-ci peut très bien être limitée au droit de diverses communautés définie par la religion de s’exprimer, sans que les individus qui la composent aient le choix d’en faire partie.
Car il est parfaitement possible pour les pouvoirs publics de se laver les mains de la question de la liberté de croire ou de ne pas croire, de la liberté de choisir sa vie, laissant des leaders religieux dire à leurs ouailles ce qu’ils et elles doivent penser, comment se vêtir, quoi manger, comment éduquer leurs enfants, avec qui se marier, etc. C’est plus facile pour l’État, il faut dire. Sous l’Ancien Régime, le roi de France se reposait ainsi sur l’Église de France de la surveillance des mœurs. Les théologiens de Sorbonne et les évêques donnaient ainsi des consignes qui avaient souvent force de loi. Pas très différent, au fond, du lien encore aujourd’hui entre théologie et droit musulman, ou entre étude de la Torah et droit judaïque.
Si on lit de près la fameuse loi de 1905, on retrouve la volonté d’émancipation qui était celle des Lumières :
Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes (…) »
Bref, une loi qui est faite pour permettre aux individus d’être libres par rapport aux religions, pas juste pour donner aux groupes religieux la possibilité de développer leur discours et leurs réseaux et de se faire concurrence pour les « parts de marché » spirituel et social. On comprend que les mouvements religieux qui ont aussi des ambitions politiques, un désir de contrôler les cœurs et les corps, n’aiment pas cela !
Mais si on croit que la liberté de conscience est un droit pour tous les habitants et habitantes de ce pays, pas seulement ceux d’ascendance européenne et de tradition chrétienne, c’est un texte précieux, à comprendre et à faire vivre.